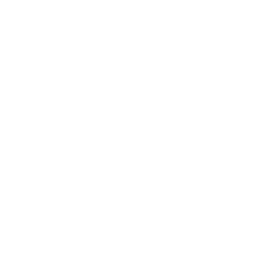Zoom sur...
Le traumatisme psychique de guerre chez les militaires
4e partie : une approche sociologique
En quatre-vingts ans, les sociétés occidentales n’ont plus connu de guerre sur leur territoire. Les conflits sont devenus « extérieurs », menés par des armées professionnelles. Pourtant le traumatisme psychique de guerre est un phénomène croissant.
En France, le nombre de militaires diagnostiqués en trouble de stress post-traumatique a été multiplié par 35 entre 2007 et 2013 (Assemblée Nationale, 2014). Aux Etats-Unis, la proportion de vétérans en état de stress post-traumatique est passée de 15% lors de la guerre du Vietnam à 23% lors des opérations Enduring Freedom en Afghanistan et Iraqi Freedom (Fulton et al., 2015).
Tandis que le sociologue Gaston Bouthoul (1970) affirme qu’« il y a peu de phénomènes sociaux qui soient aussi répandus que la guerre » (p.25), nous proposons de nous interroger sur l’étude sociologique de la guerre et sa contribution à l’appréhension d’une psychopathologie du combattant.
La guerre, un phénomène social total
L’anthropologue Lawrence H. Keeley (2012) définit la guerre « comme un état de violence mortelle entre groupes sociaux » et précise qu’elle « ne devient archéologiquement visible qu’après que les humains se soient sédentarisés ». Loin d’une initiative individuelle qui s’expliquerait par des mécanismes psychologiques, c’est donc le contact et l’apparition d’enjeux entre groupes sociaux constitués (accès aux ressources nécessaires à la survie et au développement du groupe…) qui est à l’origine du phénomène guerrier.
Empruntant l’expression à Marcel Mauss, Aurélien Berlan (2005) qualifie la guerre de phénomène social total « qui mêle et combine toutes les dimensions constitutives de la vie sociale, politique bien sûr, mais aussi économique, juridique, religieuse, technique, scientifique… ».
Mais qu’est-ce que la guerre ? Dans le cas qui nous intéresse, il s’agit d’un mode de résolution de conflit construit sur la lutte armée qui confère au combattant le droit de tuer autrui.
Or, donner la mort est un interdit d’origine sociale, et dans la guerre, c’est bien la société, au travers du pouvoir politique, qui lève momentanément cet interdit : elle donne le droit de tuer l’ennemi au travers d’un « contrat » qui prend la forme d’une déclaration de guerre, d’un mandat international, de règles d’engagement…
Afin de faciliter la désinhibition de l’acte de tuer, le politique construit une représentation sociale de l’ennemi propice à une attitude d’exodéfavoritisme[1] voire à sa deshumanisation, et organise la guerre dans une structure hiérarchique stricte allant de l’objectif politique du conflit jusqu’à la conduite d’une opération militaire spécifique en passant par la stratégie militaire.
L’armée, un groupe social spécifique
L’esprit de corps est à la base de toute organisation militaire : le groupe y prime sur l’individu. L’intégration au groupe passe par l’assimilation de ses valeurs (obéissance, solidarité, sens du sacrifice…) et par ses rituels (cérémonies, port de l’uniforme, chants…). L’armée répond à la définition d’une société à solidarité mécanique[2] telle que l’a définie Émile Durkheim (1893), qui décrit le soldat comme une personnalité « que l’on ne rencontre nulle part, au même degré, dans la vie civile » et qui « doit être prêt à […] faire le sacrifice [de sa vie] dès qu’il en a reçu l’ordre » (Durkheim, 1897, p.270).
L’éventualité du don de sa propre vie est en effet l’une des caractéristiques du métier de soldat. Elle est acceptée et ce d’autant plus que l’intégration au groupe est forte : « les combattants que l’on interroge sur leurs motivations au combat invoquent rarement un idéal, la haine ou les décorations ; ils mentionnent par contre leur volonté de ne pas laisser tomber leurs camarades d’unité, et de ne pas perdre leur estime et leur soutien » (Frésard, 2004, p.10).
Cette spécificité du métier militaire est reconnue à l’échelle politique au travers de l’hommage national rendu au soldat mort au combat (Marchal, 2013).
Des opérations extérieures à la dissonance cognitive
Après quarante-cinq années de guerre froide, les conflits armés sont revenus sur le devant de la scène sous forme d’opérations extérieures. La première Guerre du Golfe (1991), les interventions en ex-Yougoslavie (1992), l’opération Enduring Freedom en Afghanistan (2001) ou encore l’opération Serval au Mali (2013) se sont déroulées loin du territoire national.
Dès lors, la nation ne « se sent pas en guerre » et seuls les militaires, exclusivement des professionnels depuis la suspension de la conscription obligatoire en 1997, sont impliqués dans ces conflits. Ainsi, le droit de tuer l’ennemi n’est plus conféré que par le seul organe politique et non par une société toute entière dans la mesure où celle-ci se sent peu concernée par les opérations extérieures.
De plus, l’ennemi ne fait plus l’objet d’une représentation sociale précise : la justification des conflits récents réside dans des valeurs que sont les droits de l’Homme, la liberté… Non seulement l’ennemi n’est pas défini mais sur le terrain de guerre, les combattants ennemis sont mêlés aux populations civiles dont ils ne sont pas toujours distinguables.
En conséquence, pour le soldat qui accepte de donner la mort et de la recevoir en vertu d’une légitimation sociale de son action, on peut se demander dans quelle mesure l’absence de conscience sociale des opérations extérieures et le flou dans la définition de l’ennemi ne sont pas sources de dissonance cognitive[3] telle que définie par Leon Festinger.
Ajoutons à cela que les sociétés occidentales ont évolué vers une solidarité organique[4] au sens durkheimien. La différenciation des individus est devenue la règle : ainsi, se pose la question d’une éventuelle dissonance pour les soldats entre une vie professionnelle fortement intégratrice et une vie sociale fortement individualiste, où les valeurs de liberté et de droit à la vie, que défend le soldat au prix de sa propre vie, sont tenues pour acquises.
La sociologie, facteur explicatif du traumatisme psychique de guerre
Si l’évolution combinée de la société et des conflits armés est source de dissonances cognitives non résolues, celles-ci peuvent se muer en conflits psychiques qui à leur tour peuvent prendre la forme d’une psychopathologie. Ainsi, la prise en compte de l’environnement social peur s’avérer éclairante pour tenter de comprendre le traumatisme psychique de guerre et pour explorer des pistes de prévention.
[1] L’exodéfavoritisme consiste, pour un groupe social, à accentuer la différence entre groupes sociaux afin de dévaloriser un ou plusieurs autres groupes sociaux.
[2] Une société à solidarité mécanique base sa cohésion sociale sur la similitude des comportements des individus et des valeurs de la société. La conscience d’appartenir au groupe prime sur la conscience individuelle.
[3] La dissonance cognitive est un état d’inconfort psychologique provoqué par des contradictions voire des conflits entre des informations, des connaissances ou encore des comportements. Ex : « Je sais que fumer tue et pourtant, je fume. »
[4] La solidarité organique fonde sa cohésion sociale sur la complémentarité des activités et des fonctions des individus. La coopération entre individus y est nécessaire. En effet, la spécialisation de chacun entraine des besoins réciproques se traduisant par un système de droits et d’obligations entre les individus.
Références
Assemblée Nationale. (2014). Rapport d’information de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées sur la prise en charge des blessés du 16 décembre 2014. Récupéré de https://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2470.asp
Berlan, A. (2005). Structures sociales et mécanismes : la guerre dans la sociologie Weberienne. Sens Public 2005/03, Récupéré de http://www.sens-public.org/spip.php?article144
Bouthoul, G. (1970). Traité de polémologie – Sociologie des guerres. Editions Bibliothèque scientifique Payot. (p.25)
Durkheim, E. (1893). De la division du travail social.
Durkheim, E. (1897). Le suicide. Editions Petite Bibliothèque Payot.
Frésard, J-J. (2004). Origine du comportement dans la guerre - Révision de la littérature. Comité International de la Croix Rouge, octobre 2004.
Fulton, J.J., Calhoun, P.S., Wagner, H.R., Schry, A.R., Hair, L.P., Feeling, N., ... & Beckham, J.C. (2015). The prevalence of posttraumatic stress disorder in Operation Enduring Freedom/Operation Iraqi Freedom (OEF/OIF) veterans: A meta-analysis. Journal of anxiety disorders, 31, 98-107.
Keeley, L.H. (2012). Interview dans Les Grands Dossiers des sciences humaines. Hors-série Histoire n°1.
Marchal, C. (2013). L’hommage politique aux soldats français morts en Afghanistan - Une analyse sociologique. Editions L’Harmattan.
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.