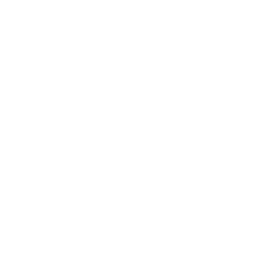Zoom sur...
Le traumatisme psychique de guerre chez les militaires
1re partie : la relation entre guerre et trauma
La relation entre guerre et traumatisme psychique ne date pas d’hier. Elle est rapportée dès l’Antiquité par Hérodote à propos de la bataille de Marathon en 490 avant notre ère (Crocq, 1999) :
« Un Athénien, Épizèlos fils de Couphagoras, perdit soudain la vue tandis qu’il luttait en homme de coeur au milieu de la mêlée, et ce sans avoir reçu le moindre coup, ni de près ni de loin ; dès lors, il fut aveugle pour le restant de sa vie. Voici, m’a-t-on dit, comme il expliquait son malheur : il avait cru voir devant lui un homme de haute taille dont la barbe couvrait tout le bouclier ; l’apparition avait passé sans le toucher, mais avait tué son camarade à côté de lui. »
Pourquoi s’intéresser à la guerre lorsque l’on étudie le psychotraumatisme ? Quelle est l’ampleur du traumatisme psychique de guerre ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre grâce aux apports de la littérature scientifique d’une part mais également au travers d’essais et d’autobiographies de militaires exposés au combat.
Pourquoi s’intéresser au psychotraumatisme de guerre ?
La guerre, un phénomène psychologique extra-ordinaire
Définie comme un mode de résolution de conflit construit sur la lutte armée, la guerre confère au combattant le droit de tuer autrui. Il s’agit de l’une des rares circonstances levant l’interdiction sociale, de façon temporaire et légale, d’ôter la vie à un autre être humain. En cela, la guerre est une activité qui revêt un caractère d’exception sur le plan social.
Goya (2015) ajoute que « le combat n’est pas un phénomène « normal », c’est un événement extraordinaire et les individus qui y participent ne le font pas de manière « moyenne ». […] la proximité de la mort et la peur qu’elle induit déforment les individus et étirent leur comportement vers les extrêmes. » (p.23)
La guerre est, en effet, caractérisée par l’intensité de ce qui y est vécu. Intensité des horreurs du combat mais également intensité dans le dépassement de soi et dans la relation à l’Autre. Actions hors normes et fraternité d’arme sont mises en avant par Jesse Glenn Gray (1959), engagé dans les combats de la seconde guerre mondiale :
« Quels sont donc les charmes secrets de la guerre […] ? Je crois qu’ils comprennent : la jouissance de voir, la jouissance de la fraternité, la jouissance de la destruction. » (p.72)
« Cet attrait de la guerre est ordinairement décrit comme le désir d’échapper à la monotonie de la vie civile et aux restrictions oppressantes d’une existence dépourvue d’aventure. […] Quoiqu’il soit bien connu que la guerre offre son lot d’ennui et de monotonie, elle offre aussi de l’insolite, de l’exotique et de l’étrange. Elle donne l’occasion d’un ébahissement devant d’autres terres et d’autres peuples, devant d’étranges engins de guerre et d’autres unités marchant au pas, ou encore devant l’ennemi captif derrière les barreaux. » (p.73)
Richard Hillary (1942), étudiant à Oxford au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, s’engage dans la Royal Air Force et témoigne :
« La guerre résolvait tous les problèmes que me posait le choix d’une carrière et m’offrait une chance d’affirmer ma personnalité. Ce développement, dans des circonstances normales, eût pris des années. Comme pilote de chasse, j’espérais connaître à la fois le plaisir, la peur et l’exaltation : synthèse que toute autre forme d’existence n’eût pu m’offrir.
Je ne fus pas déçu. » (p.69)
Voir dans la guerre un phénomène « positif » peut sembler contre-intuitif. Poussons donc la réflexion un peu plus loin.
La guerre comme vecteur de progrès médical
Les guerres napoléoniennes ont conduit au développement de la chirurgie d’urgence. La reconstruction maxillo-faciale a largement progressé avec la première guerre mondiale.
Sur le plan psychiatrique, les conséquences de la guerre du Vietnam ont permis une avancée majeure sur le plan diagnostique. On recense en effet 700 000 cas de « Post-Vietnam Syndrome » sur les 3 millions de soldats américains envoyés au Vietnam (Crocq, 1999). Cette situation, ainsi que la pression sociale pour un droit à la reconnaissance et à la réparation, donneront lieu à l’introduction en 1980 du diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT) dans le DSM-III (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 3e édition).
Au cours des quarante-cinq dernières années, le TSPT a fait l’objet de recherches considérables, permettant d’en préciser ses symptômes. Mais il a permis de mieux appréhender les troubles éprouvés par des victimes civiles, indépendamment de tout phénomène guerrier. Accidents, agressions physiques ou sexuelles, catastrophes naturelles… ont été reconnus comme des événements potentiellement traumatiques. Ainsi, la guerre et ses conséquences psychiques ont permis des avancées considérables avec l’émergence du TSPT reconnu comme trouble à part entière. Ces progrès se sont manifestés dans le domaine médico-psychologique du repérage et du soin du TSPT, dans la sphère juridique avec le droit à réparation, dans le champ de la recherche avec l’émergence de la victimologie comme discipline…
Si les progrès se produisent sous pression, alors la guerre est sans aucun doute un phénomène intense où les événements traumatogènes, c’est-à-dire ayant le potentiel de faire trauma, se produisent à répétition.
La guerre, un condensé traumatogène
Expositions multiples à des événements traumatogènes
La guerre est un terrain d’expositions multiples « à la mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave » (critère A du TSPT dans le DSM-5). En contexte de guerre, le soldat :
- Est exposé à la menace de recevoir la mort ou d’être grièvement blessé,
- Risque d’observer la mort infligée à autrui, notamment à ses camarades,
- Peut être amené à donner la mort, action considérée comme hautement traumatogène en raison notamment de la répugnance de l’Homme à tuer un autre être humain, même en situation de légitime défense (Grossman, 2009 ; Litz et al., 2009). Précisons que cette réticence à tuer est proportionnelle à la proximité physique entre le combattant et son ennemi (Goya, 2015 ; Grossman, 2009).
En contexte de guerre, ces situations traumatogènes sont répétées, mais sans générer de phénomène d’habituation, comme le relate Goya (2015) :
« L’accoutumance n’est cependant pas forcément synonyme de renforcement psychologique, car elle se conjugue aussi avec un phénomène d’usure. L’approche d’un nouveau combat fait resurgir des souvenirs refoulés et accroît la tension. Pour Jünger, ‘c’est une erreur de croire qu’au cours d’une guerre le soldat s’endurcit et devient plus brave. Ce qu’on gagne dans le domaine de la technique, dans l’art d’aborder l’adversaire, on le perd de l’autre côté en force nerveuse.’ » (p.53)
Ces situations potentiellement traumatiques peuvent néanmoins être compensées par des facteurs de protection. Ces derniers peuvent agir comme des éléments de prévention du développement d’un traumatisme psychique.
Facteurs de protection
Lors des phases et de formation et de préparation du soldat, le développement de l’esprit de corps et l’entraînement physique, technique et tactique au combat constituent des éléments de défense psychique (Grossman, 2009 ; Litz et al., 2009).
Durant les opérations de guerre, les facteurs protecteurs résident dans l’action par opposition au figement et à son vécu d’impuissance (de Vitton, 2012) et dans les règles d’engagement qui donnent un cadre au combat. Mais par-dessus tout, c’est le groupe qui apporte un soutien collectif salutaire (Litz et al., 2009).
« D’innombrables soldats sont morts, plus ou moins volontairement, non pour leur patrie, leur honneur ou leur foi religieuse, ou pour tout autre bien abstrait, mais parce qu’ils avaient conscience que, en abandonnant leur poste pour sauver leur vie, ils exposeraient leurs compagnons à de plus grands périls. Le moral du combattant a pour essence cette loyauté envers le groupe. » (Gray, 1959, p.84-85)
Et au retour d’opération, le soutien social reçu et perçu s’avère primordial comme ressource protégeant du développement d’un TSPT (Blais et al., 2021).
Comme nous venons de le voir, les opérations de guerre sont des lieux d’expositions multiples à des événements traumatogènes mais il est possible de développer des facteurs de protection contre le trauma. Néanmoins, protection ne saurait être synonyme d’invincibilité. Quelle est donc l’ampleur épidémiologique du psychotraumatisme de guerre ?
Épidémiologie du traumatisme psychique de guerre
La méta-analyse de Fulton et al. (2015) établit une prévalence de TSPT de 23% parmi les vétérans américains engagés dans les opérations Enduring Freedom et Iraqi Freedom, avec des taux allant de 1,4% à 60% selon les études.
En France, l’INSERM (2020) estime que près d’un quart des militaires ayant participé à une opération de guerre souffre de TSPT.
Cependant, ces chiffres sont à analyser avec précaution. En effet, le recensement des diagnostics de TSPT chez les militaires est affecté par plusieurs facteurs :
- Compte tenu du possible temps de latence entre le ou les événement(s) traumatique(s) et l’apparition des symptômes, certains TSPT se manifestent après la fin de contrat du militaire, c’est-à-dire après son départ de l’institution militaire.
- Certains cas de TSPT peuvent ne pas être détectés parce que masqués par une comorbidité (addictions, troubles dépressifs, troubles anxieux…).
- Certains militaires ne signalent pas leurs symptômes par crainte d’être stigmatisés ou de se voir déclarés inaptes.
Ce dernier point constitue une barrière majeure à l’accès aux soins psychiques, sujet abordé dans l’article Traumatisme psychique de guerre chez les militaires - 2e partie : spécificités des approches thérapeutiques.
Références
Blais, R.K., Tirone, V., Orlowska, D., Lofgreen, A., Klassen, B., Held, P., Stevens, N. et Zalta, A.K. (2021). Self-reported PTSD symptoms and social support in U.S. military service members and veterans: a meta-analysis. European journal of psychotraumatology, 12(1), 1851078.
Crocq, L. (1999). Les traumatismes psychiques de guerre. Odile Jacob.
Fulton, J. J., Calhoun, P. S., Wagner, H. R., Schry, A. R., Hair, L. P., Feeling, N., ... & Beckham, J. C. (2015). The prevalence of posttraumatic stress disorder in Operation Enduring Freedom/Operation Iraqi Freedom (OEF/OIF) veterans: A meta-analysis. Journal of anxiety disorders, 31, 98-107.
Goya, M. (2015). Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail. Texto
Gray, J.G. (1959). Au combat. Réflexion sur les hommes à la guerre. [trad. Simon Duran]. Tallandier.
Grossman, D. (2009). On Killing. The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society. Back Bay Books.
Hillary, R. (1942). Le dernier ennemi. Bataille d’Angleterre juin 1940-mai 1941. Tallandier
INSERM (2020). Troubles du stress post-traumatique. Quand un souvenir stressant altère les mécanismes de mémorisation. Récupéré de https://www.inserm.fr/dossier/troubles-stress-post-traumatique/ le 22/03/2025
Litz, B.T., Stein, N., Delaney, E., Lebowitz, L., Nash, W.P., Silva, C. et Maguen, S. (2009). Moral injury and moral repair in war veterans: A preliminary model and intervention strategy. Clinical psychology review, 29(8), 695-706.
de Vitton, I. (2012). Psychotraumatologie. Apports de la Psychiatrie Militaire et de la Psychiatrie Civile. [thèse de doctorat, Université de Rouen, France]. Récupéré de https://coilink.org/20.500.12592/8jq7e4q le 27/12/2024. COI: 20.500.12592/8jq7e4q.
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.